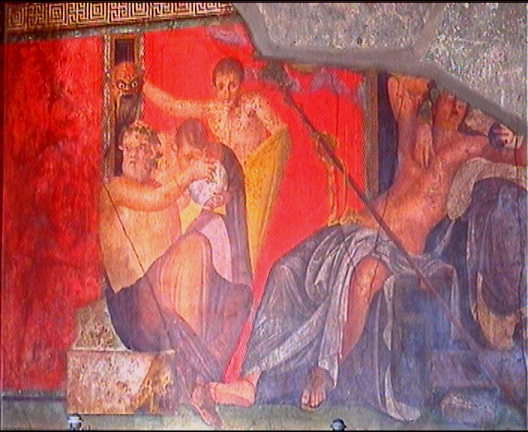|
Comment comprendre cette scène
? Comment interpréter le vase (skyphos ou cotyle ?) que
tend un vieux silène à son jeune compagnon au regard
mi-fasciné mi-terrifié ? S'agit-il d'un miroir
oraculaire où le jeune initié découvre une
scène prophétique flottant à la surface
du vin ou sur les parois du vase
?  Pour les lecteurs du Miroir
de Baltrusaitis, il y a là une formidable leçon
de catoptrique Pour les lecteurs du Miroir
de Baltrusaitis, il y a là une formidable leçon
de catoptrique où le peintre semble aller jusqu'à
démystifier les subterfuges de l'initiation ; car un comparse,
qui se tient derrière le jeune myste, brandit le masque
d'un silène ivre qui se reflète dans le miroir
magique. Attentif à diriger correctement le masque, il
semble sourire de la naïveté de son jeune compagnon.
Il me semble d'autant plus intéressant d'interroger cette
hypothèse du miroir que c'est au moment où Dionysos
était "ailleurs" où le peintre semble aller jusqu'à
démystifier les subterfuges de l'initiation ; car un comparse,
qui se tient derrière le jeune myste, brandit le masque
d'un silène ivre qui se reflète dans le miroir
magique. Attentif à diriger correctement le masque, il
semble sourire de la naïveté de son jeune compagnon.
Il me semble d'autant plus intéressant d'interroger cette
hypothèse du miroir que c'est au moment où Dionysos
était "ailleurs" , fasciné par sa
propre image dans le miroir que les Titans avaient glissé
parmi les jouets de la corbeille, qu'il fut capturé pour
être démembré. Or ce reflet menteur en évoque
un autre ; car un amour ailé tend lui aussi un
miroir à la jeune femme qui se pare pour le jour de
ses noces et le peintre n'a pas manqué de représenter
fidèlement son
reflet , fasciné par sa
propre image dans le miroir que les Titans avaient glissé
parmi les jouets de la corbeille, qu'il fut capturé pour
être démembré. Or ce reflet menteur en évoque
un autre ; car un amour ailé tend lui aussi un
miroir à la jeune femme qui se pare pour le jour de
ses noces et le peintre n'a pas manqué de représenter
fidèlement son
reflet . Si, à
l'évidence, certaines scènes de la frise s'appellent
et se répondent comme en écho, il me semble qu'il
faudrait aussi analyser cette symétrie des miroirs. Où
est la réalité, où est l'illusion ? La symbolique
de la fresque, qui suppose le dédoublement entre le mariage
tout humain de l'initiée et la part divine de son initiation
mystique, me semble une mise en abyme très moderne de
cette rhétorique des reflets. . Si, à
l'évidence, certaines scènes de la frise s'appellent
et se répondent comme en écho, il me semble qu'il
faudrait aussi analyser cette symétrie des miroirs. Où
est la réalité, où est l'illusion ? La symbolique
de la fresque, qui suppose le dédoublement entre le mariage
tout humain de l'initiée et la part divine de son initiation
mystique, me semble une mise en abyme très moderne de
cette rhétorique des reflets.
Pourtant, ni Gilles Sauron ni Paul
Veyne n'interprètent cette image énigmatique en
relation avec le miroir oraculaire : notre jeune silène
boit comme on boit à l'eau d'une source, affirme Gilles
Sauron. Mais cette source est une source de vin. Il faut en effet
comparer cette scène à
la précédente : Dionysos est ici le dieu civilisateur qui donne aux hommes
le vin de la culture en lieu et place du lait de la nature. La
pierre taillée sur laquelle est assis le vieux silène
couronné de lierre en témoigne, nous ne sommes
plus ici dans les montagnes du Parnasse où s'ébattent
les bergers du dieu Pan mais bien sur l'agora de quelque cité
grecque. Aux pieds nus de la scène précédente
ont d'ailleurs succédé les chaussures fermées
de la vie civilisée. Quant au jeune silène qui
pose son himation de couleur safran, il serait prêt à
se couvrir du masque qu'il brandit pour célébrer
l'une de ces danses dont Platon écrit qu'elles miment
des gens ivres dans certaines initiations. Selon Pierre Grimal,
des masques évoquant les génies de la terre et
de la fécondité étaient effectivement présents
dans le cortège dionysiaque. Les silènes que l'on
voyait tout à l'heure dans
la nature
: Dionysos est ici le dieu civilisateur qui donne aux hommes
le vin de la culture en lieu et place du lait de la nature. La
pierre taillée sur laquelle est assis le vieux silène
couronné de lierre en témoigne, nous ne sommes
plus ici dans les montagnes du Parnasse où s'ébattent
les bergers du dieu Pan mais bien sur l'agora de quelque cité
grecque. Aux pieds nus de la scène précédente
ont d'ailleurs succédé les chaussures fermées
de la vie civilisée. Quant au jeune silène qui
pose son himation de couleur safran, il serait prêt à
se couvrir du masque qu'il brandit pour célébrer
l'une de ces danses dont Platon écrit qu'elles miment
des gens ivres dans certaines initiations. Selon Pierre Grimal,
des masques évoquant les génies de la terre et
de la fécondité étaient effectivement présents
dans le cortège dionysiaque. Les silènes que l'on
voyait tout à l'heure dans
la nature  sont devenus
ici les compagnons du Dionysos civilisateur dont ils sont désormais
les prophètes : "Ils ont été envoyés
par leur maître, écrit Euripide dans Les
Bacchantes, pour proclamer sa divinité en Grèce"... sont devenus
ici les compagnons du Dionysos civilisateur dont ils sont désormais
les prophètes : "Ils ont été envoyés
par leur maître, écrit Euripide dans Les
Bacchantes, pour proclamer sa divinité en Grèce"...
Pour Paul Veyne, l'explication est
plus prosaïque : la scène représenterait le
rite de passage au cours duquel on donnait "du vin à
boire aux garçonnets pour la première fois de leur
vie". Cette initiation au vin avait lieu au printemps,
lors de la grande fête de Dionysos et c'est donc à
travers une image
convenue  (Silène
donnant à boire à un jeune satyre dans le "chous"
destiné à ce rite), que le peintre aurait représenté
l'initiation du garçon au vin comme il a représenté
celle de la fille à l'amour à travers l'image convenue
de l'ostentation du phallus. (Silène
donnant à boire à un jeune satyre dans le "chous"
destiné à ce rite), que le peintre aurait représenté
l'initiation du garçon au vin comme il a représenté
celle de la fille à l'amour à travers l'image convenue
de l'ostentation du phallus.
Mais, tandis que s'accomplit ce
rite, l'autre satyre fait une farce à la jeune fille qui
se trouve à la droite du Silène, sur le mur contigu.
Il brandit un masque d'épouvante (autre image courante
dans l'iconographie gréco-romaine) ; le Silène,
tout occupé à initier son jeune compagnon au vin,
n'a rien vu mais, au cri d'effroi que pousse la jeune fille,
il tourne vers elle un regard interrogateur. |